 Cette information est archivée à des fins de consultation ou de recherche.
Cette information est archivée à des fins de consultation ou de recherche.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Critiques de livres
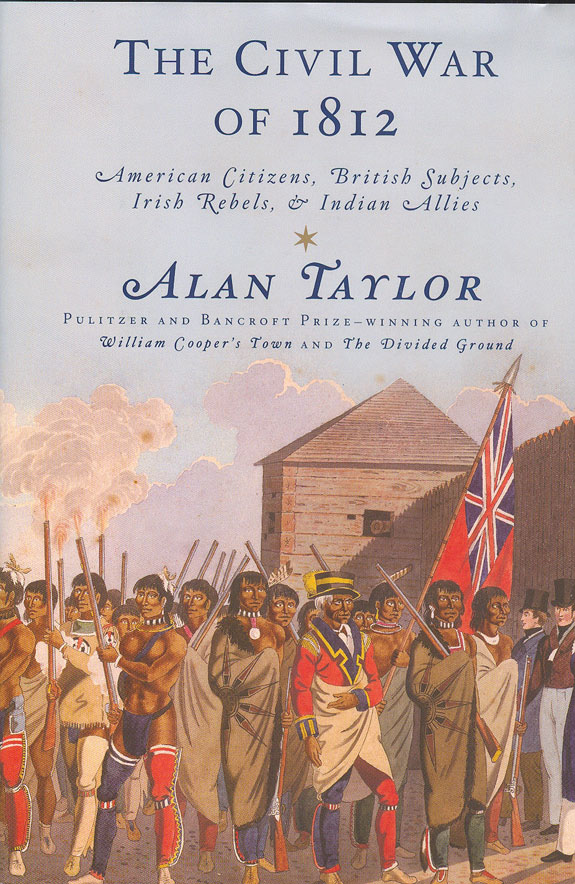
THE CIVIL WAR OF 1812: AMERICAN CITIZENS, BRITISH SUBJECTS, IRISH REBELS AND INDIAN ALLIES
par Alan Taylor
Pour plus d'information sur l'accessibilité de ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
THE CIVIL WAR OF 1812: AMERICAN CITIZENS, BRITISH SUBJECTS, IRISH REBELS AND INDIAN ALLIES
par Alan Taylor
New York : Alfred Knopf, 2010.
620 pages, deux cartes, 77 illustrations, notes, bibliographie, index, 25,50 $, couverture en tissu
Critique par John Grodzinski
L’ouvrage The Civil War of 1812 relate le conflit anglo-américain, qui a pris la forme d’une série d’affrontements civils le long de la frontière du Haut-Canada entre 1812 et 1815. Selon Alan Taylor, qui enseigne l’histoire américaine et canadienne à la University of California, la guerre de 1812 a quatre dimensions, chacune représentant un combat en soi. La première est la lutte constante entre les Loyalistes et les Américains pour le contrôle du Haut‑Canada; la deuxième est la partisanerie politique qui régnait aux États-Unis et qui a bien failli déclencher une guerre entre les États; la troisième est la transposition à la frontière de l’Amérique du Nord britannique de la lutte pour l’indépendance de l’Irlande par rapport à la Grande-Bretagne; et finalement, la quatrième est le conflit entre les peuples autochtones vivant des deux côtés de la frontière. L’auteur consacre 620 pages à en faire une analyse imposante et parfois dense qui semble ne pas être appuyée sur des recherches aussi approfondies ni être si clairement rédigée que ne le suggèrent les notes figurant sur la jaquette.
Pour étayer son argumentation, l’auteur se concentre sur les événements qui se sont déroulés le long des frontières du Haut-Canada. Selon lui, durant les trois saisons de campagne, ni la Grande-Bretagne, ni les États-Unis n’ont su imposer leur vision de l’Amérique du Nord, impériale ou républicaine; ils décidèrent donc de coexister. Ce raisonnement suppose que l’objectif ultime de la Grande-Bretagne était d’écraser la nouvelle république, ce qui est faux. Puisque l’auteur restreint la perspective britannique de la guerre aux événements qui ont eu lieu aux abords du Haut-Canada, une grande partie du contexte britannique est perdu. Par exemple, les chefs politiques britanniques sont réduits à un groupe d’anonymes appelés « Lords impériaux » (ce terme est utilisé fréquemment, notamment aux pages 78, 150, 172, 403 et 435). Le roi George III, qui était malade à ce moment et est resté complètement étranger à cette guerre, est mentionné quatre fois, tandis que le prince régent, qui a assumé bon nombre des responsabilités du monarque en 1811, est à peine évoqué. Le premier ministre, le comte de Liverpool est ignoré, et le comte Bathurst, secrétaire d'État à la guerre et aux colonies et représentant du cabinet responsable du déroulement de la guerre, n’est nommé qu’une fois (p. 290). Contrairement à leurs homologues britanniques anonymes, les chefs politiques et militaires américains, dont James Madison, James Monroe, James Wilkinson, Jacob Brown, Thomas Jefferson, et même George Washington sont mentionnés tout au long du livre.
Par conséquent, la stratégie britannique, du moins jusqu’au 13 octobre 1812, est présentée comme une lutte entre le fougueux et costaud Major‑General Isaac Brock et le prudent capitaine-général et gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique, le Lieutenant‑General Sir George Prevost. Les raisons justifiant l’envoi massif de renforts en Amérique du Nord par la Grande-Bretagne en 1814 ne sont jamais expliquées exhaustivement, et la guerre en Europe contre Bonaparte est à peine décrite. Les instructions du prince régent à l’intention du Lieutenant‑General Prevost, écrites en 1811, indiquaient clairement qu’il devait éviter toute situation qui engendrerait une réallocation majeure des ressources qui se trouvaient en Europe. Toutefois, lorsque les circonstances dictant cette stratégie changèrent, la Grande‑Bretagne envoya des renforts considérables en Amérique du Nord en 1814, pas tant pour intimider les Américains (p. 413) que pour contrôler les frontières du Haut‑Canada et du Bas‑Canada en prévision des pourparlers de paix imminents.
Certes, le Haut-Canada était le point névralgique de la guerre, mais, par sa décision de restreindre la discussion à cette province, l’auteur fait abstraction du rôle qu’a joué le reste de l’Amérique du Nord britannique. Il n’accorde que peu de considération à la population majoritairement francophone du Bas-Canada, qui comptait pour environ la moitié des 600 000 habitants de l’Amérique du Nord britannique. Le Bas‑Canada est étrangement décrit comme un « pays catholique occupé par des troupes britanniques » qui « ressemble à une Irlande à la française » (p. 77). Pourtant, cette colonie a joué un rôle important dans l’effort de guerre. Dans les Maritimes, la Nouvelle‑Écosse et le Nouveau‑Brunswick entretenaient des liens culturels et économiques étroits avec la Nouvelle‑Angleterre, alors pourquoi passer sous silence la dynamique républicaine-impériale qui existait dans cette région?
Les peuples autochtones occupent une place importante dans l’ouvrage, et, comme le reconnaît l’auteur, ont contribué à faire échouer les plans américains en 1812 et 1813 (p. 435). Une fois la paix conclue, bon nombre des alliés autochtones de la Grande-Bretagne se sont retrouvés en territoire américain, et l’auteur soutient que les États-Unis ont tiré parti du traité de paix « ambigu » (p. 437) pour consolider leur domination sur les peuples autochtones dans leur territoire, les coupant de leurs influences britanniques, et sur le continent. L’abandon manifeste par la Grande-Bretagne de ses alliés autochtones est un thème récurrent dans l’historiographie War of 1812. Or, l’auteur banalise les efforts de la Grande-Bretagne pour protéger les droits des autochtones dans le neuvième article du Traité, ainsi que la décision des États-Unis d’ignorer ces clauses.
Qui plus est, l’ensemble de l’ouvrage est truffé d’erreurs mineures. Aucune n’est terriblement grave, mais il y en a suffisamment pour détourner l’attention du lecteur et l’amener à remettre en question la compréhension qu’a l’auteur de la façon dont les Britanniques ont perçu cette guerre. Ainsi, en 1785, les installations défensives de Québec ne comprenaient pas une citadelle (p. 14); Guy Carleton ne se serait certainement pas décrit comme un « Irlandais loyal » (p. 17); il n’y avait pas 100 000 sujets britanniques au « Canada » en 1785 (p. 27), bien que l’étendue géographique de l’entité n’est pas définie. Pourquoi ne pas avoir utilisé les données du recensement réalisé au début des années 1800? Peter Hunter est identifié à tort comme le gouverneur‑général du Canada, alors qu’il était en fait lieutenant-gouverneur du Haut‑Canada entre 1799 et 1805 (p. 87); la date de l’abrogation du décret en conseil en 1812 est erronée (p. 134); et c’est le prince régent, et non le Parlement, qui a ratifié le Traité de Gand le 27 décembre 1814 (p. 419).
Quoique décevant à l’égard de la perspective britannique, ce livre révèle plusieurs points de vue intéressants : une population qui n’avait pas été entièrement divisée par la guerre d’indépendance des États-Unis a acquis une identité plus distincte après la guerre de 1812; le seul résultat quantifiable du conflit est la confirmation de la frontière existante entre l’Amérique et l’Amérique du Nord britannique. L’auteur fournit également des exemples intéressants de différences entre le Haut‑Canada et la République américaine d’avant la guerre, comme le fardeau fiscal moins élevé des habitants du Haut-Canada comparativement à celui des Américains. La manière dont l’auteur décrit les interactions entre les soldats et les civils est saisissante et se démarque des autres ouvrages. Par exemple, les opérations des deux éminentes divisions américaines dans la péninsule de Niagara durant l’été et l’automne 1814, bien que courageuses, n’ont pas vraiment contribué à assurer la victoire aux États-Unis, et ont en fait « …gaspillé le talent des meilleurs soldats du pays dans des batailles futiles » (p. 407). Les succès tactiques ne compensent pas les échecs stratégiques, et il semble que pour l’auteur, la leçon à tirer de cette guerre soit que, du moins superficiellement, l’impression de victoire que les Américains ont entretenue à la suite de la guerre n’était qu’illusoire.
Le Major John R. Grodzinski, CD, Ph. D., est un officier de l’Arme Blindée et il enseigne l’histoire au Collège militaire royal du Canada, à Kingston. Il dirige également des visites de champs de bataille associés à la guerre de 1812.






